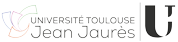-
Partager cette page
Thèse Pierre CAMES
30/09/2025 à 14 h - D 29 (MDR)
Titre
Jury
CHÂTEAUREYNAUD, Marie-Anne, Professeure des universités, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) de Bordeaux, INSPE BX (Rapporteur)
VIDEGAIN Charles, Professeur émérite, Université de Pau et des Pays de l’Adour (rapporteur)
BRUN-TRIGAUD Guylaine, Ingénieure CNRS - Université Côte d’Azur (Examinateur)
LIEUTARD Hervé ,Professeur des universités, Université Paul Valéry (Examinateur)
SICHEL-BAZIN Rafèu, Maître de conférences, Université Toulouse II Jean Jaurès (Examinateur)
VAN HEEMS Gilles , Maître de conférences, Université Lumière – Lyon 2 (Examinateur)
SAUZET Patrick, Professeur émérite, Université Toulouse II Jean Jaurès, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (Directeur de thèse)
CARRERA BAIGET Aitor, Professeur agrégé, Universitat de Lleida (co Directeur de thèse)
Résumé
Le gascon possède des traits lexicaux, phonologiques et syntaxiques faisant de lui un cas singulier dans l'ensemble occitan au point que cette appartenance ait parfois été discutée (Bec, 1973 ; Chambon & Greub, 2002 ; Lafitte, 2005). Une des raisons avancés à certaines ces spécificités est l’existence d’un substrat basco-aquitain (par opposition au substrat gaulois ou celtique du reste de l’occitan). Dans un premier temps, les investigations ont donc consisté à recueillir et analyser les différentes théories attribuant au substrat basco-aquitain la paternité de traits spécifiques au dialecte gascon au travers des différents travaux en faisant mention. Ces arguments ont été comparés aux évolutions similaires dans d'autres langues romanes (castillan, aragonais, catalan) attribuées à ce même substrat et d'autres traits spécifiques du gascon pour lesquelles l’influence du substrat a été évoquée, principalement dans les travaux postérieurs à Jungemann (1955) pour la phonétique ainsi que la morphosyntaxe. Enfin, l'objet central de ce travail porte sur la question du lexique considéré comme d’origine substratique par Rohlfs (1935) puis plus récemment, notamment par Guilhemjoan (2022), en étudiant la distribution géographique au regard des données des atlas linguistiques du domaine occitan qui font partie de l’ensemble des Atlas linguistiques de la France par régions. Cette étude se fonde sur l'établissement de fiches lexicographiques comportant une cartographie générée à partir de la base THESOC où sont compilées les données des atlas linguistiques sus-cités. Les cartes produites sont commentées et analysées au regard des travaux existant sur l’étymologie des termes étudiés, notamment à travers la version actualisée du FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch) initié par Walther von Wartburg. Quelques cartes complémentaires ont ainsi également été générées et étudiées à partir d'éléments compilés par Rohlfs (Rohlfs 1935) lui-même et amendée dans sa version la plus récente (Rohlfs 1977) ainsi que ceux amassés par Séguy dans sa thèse (Séguy 1953) afin d'appréhender la répartition dans la zone pyrénéenne du vocabulaire spécifique au milieu montagnard. Nous proposons ensuite une analyse synthétique dont le but est d'évaluer le bien-fondé de l’attribution d’un caractère bascoïde aux mots que l’on a pu apparenter avec le basque. Nous nous attacherons aussi à catégoriser ces emprunts afin de déterminer si les différences que l’on observe nous permettent de les interpréter comme relevant d'un effet de substrat ou bien plutôt comme étant le fruit d'une dynamique d'adstrat, ancienne ou récente. Par ailleurs, cette analyse géolinguistique a pour objet d’essayer de comprendre comment certains termes comme estauviar ou esquèrra, envisagés sous le prisme d’une origine substratique, ont pu se diffuser bien au-delà du seul espace gascon et selon quelles dynamiques. Enfin, il est aussi question de déterminer, à travers les mots plus ou moins bien localisés, s'il existe en Gascogne une typologie régionale des emprunts faits au basque et de tenter d'en déterminer les causes. Ainsi, le propos de cette thèse est-il de proposer une vision d'ensemble de la question du substrat basco-aquitain en gascon en intégrant une lecture géolinguistique claire qui prend aussi en compte l’inscription du gascon dans l’ensemble occitan et complétant les déductions étymologiques afin d’apporter un regard inédit et complémentaire sur la question du substrat en gascon.
Titre
La question du substrat basco-aquitain en gascon à la lumière des Atlas linguistiques du domaine occitan
Jury
CHÂTEAUREYNAUD, Marie-Anne, Professeure des universités, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) de Bordeaux, INSPE BX (Rapporteur)
VIDEGAIN Charles, Professeur émérite, Université de Pau et des Pays de l’Adour (rapporteur)
BRUN-TRIGAUD Guylaine, Ingénieure CNRS - Université Côte d’Azur (Examinateur)
LIEUTARD Hervé ,Professeur des universités, Université Paul Valéry (Examinateur)
SICHEL-BAZIN Rafèu, Maître de conférences, Université Toulouse II Jean Jaurès (Examinateur)
VAN HEEMS Gilles , Maître de conférences, Université Lumière – Lyon 2 (Examinateur)
SAUZET Patrick, Professeur émérite, Université Toulouse II Jean Jaurès, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (Directeur de thèse)
CARRERA BAIGET Aitor, Professeur agrégé, Universitat de Lleida (co Directeur de thèse)
Résumé
Le gascon possède des traits lexicaux, phonologiques et syntaxiques faisant de lui un cas singulier dans l'ensemble occitan au point que cette appartenance ait parfois été discutée (Bec, 1973 ; Chambon & Greub, 2002 ; Lafitte, 2005). Une des raisons avancés à certaines ces spécificités est l’existence d’un substrat basco-aquitain (par opposition au substrat gaulois ou celtique du reste de l’occitan). Dans un premier temps, les investigations ont donc consisté à recueillir et analyser les différentes théories attribuant au substrat basco-aquitain la paternité de traits spécifiques au dialecte gascon au travers des différents travaux en faisant mention. Ces arguments ont été comparés aux évolutions similaires dans d'autres langues romanes (castillan, aragonais, catalan) attribuées à ce même substrat et d'autres traits spécifiques du gascon pour lesquelles l’influence du substrat a été évoquée, principalement dans les travaux postérieurs à Jungemann (1955) pour la phonétique ainsi que la morphosyntaxe. Enfin, l'objet central de ce travail porte sur la question du lexique considéré comme d’origine substratique par Rohlfs (1935) puis plus récemment, notamment par Guilhemjoan (2022), en étudiant la distribution géographique au regard des données des atlas linguistiques du domaine occitan qui font partie de l’ensemble des Atlas linguistiques de la France par régions. Cette étude se fonde sur l'établissement de fiches lexicographiques comportant une cartographie générée à partir de la base THESOC où sont compilées les données des atlas linguistiques sus-cités. Les cartes produites sont commentées et analysées au regard des travaux existant sur l’étymologie des termes étudiés, notamment à travers la version actualisée du FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch) initié par Walther von Wartburg. Quelques cartes complémentaires ont ainsi également été générées et étudiées à partir d'éléments compilés par Rohlfs (Rohlfs 1935) lui-même et amendée dans sa version la plus récente (Rohlfs 1977) ainsi que ceux amassés par Séguy dans sa thèse (Séguy 1953) afin d'appréhender la répartition dans la zone pyrénéenne du vocabulaire spécifique au milieu montagnard. Nous proposons ensuite une analyse synthétique dont le but est d'évaluer le bien-fondé de l’attribution d’un caractère bascoïde aux mots que l’on a pu apparenter avec le basque. Nous nous attacherons aussi à catégoriser ces emprunts afin de déterminer si les différences que l’on observe nous permettent de les interpréter comme relevant d'un effet de substrat ou bien plutôt comme étant le fruit d'une dynamique d'adstrat, ancienne ou récente. Par ailleurs, cette analyse géolinguistique a pour objet d’essayer de comprendre comment certains termes comme estauviar ou esquèrra, envisagés sous le prisme d’une origine substratique, ont pu se diffuser bien au-delà du seul espace gascon et selon quelles dynamiques. Enfin, il est aussi question de déterminer, à travers les mots plus ou moins bien localisés, s'il existe en Gascogne une typologie régionale des emprunts faits au basque et de tenter d'en déterminer les causes. Ainsi, le propos de cette thèse est-il de proposer une vision d'ensemble de la question du substrat basco-aquitain en gascon en intégrant une lecture géolinguistique claire qui prend aussi en compte l’inscription du gascon dans l’ensemble occitan et complétant les déductions étymologiques afin d’apporter un regard inédit et complémentaire sur la question du substrat en gascon.