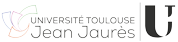-
Partager cette page
Thèse Victoria O'Callaghan
26/05/2025 à 14 h - D 29 (MDR)
Titre
Jury
Sophie HERMENT, Professeure, Université d'Aix-Marseille (rapporteur)
Alice HENDERSON, Professeure, Université Grenoble Alpes(rapporteur)
Paolo MAIRANO, Maître de conférences, Université de Lille (examinateur)
André TRICOT, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3 (examinateur)
Anne PRZEWOZNY-DESRIAUX, Professeure, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (Directrice de thèse)
Julie LEMARIE, Professeure, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (co Directrice de thèse)
Résumé
Lorsqu’un chercheur français présente ses travaux en anglais dans un contexte international, sa prononciation est-elle un obstacle à l’intelligibilité et la compréhensibilité de son discours ou au contraire, une difficulté désirable qui conduit les auditeurs à focaliser davantage leur attention ? De nombreux travaux ont été menés sur les différentes variétés L2, mais peu de recherches se sont concentrées sur le discours en L2 dans un contexte académique. Pourtant, les enjeux associés à l’efficacité de la communication dans ce contexte précis sont importants à la fois pour les individus au plan social mais aussi pour le développement de la recherche française à l’international. La thèse se fonde sur une approche interdisciplinaire avec deux études : 1) un protocole sociophonologique qui permet d’examiner le système interphonologique de chercheurs français en psychologie, et 2) un protocole expérimental visant à évaluer l’impact d’une prononciation française sur l’intelligibilité et la compréhensibilité en fonction de la langue maternelle (L1) de l’interlocuteur (anglais ou français) et du degré d’accent (marqué, non-marqué ou L1). Dans la première étude inspirée du cadre sociophonologique variationniste du programme Phonologie de l'anglais contemporain (PAC), treize chercheurs français en psychologie ont réalisé différentes tâches en production orale, constituant ainsi un corpus dédié à l’analyse acoustique et descriptive. Une condition contrôle pour la deuxième étude est élaborée sur la base de ces mêmes tâches réalisées par trois locuteurs anglophones avec un accent Southern British English (SBE). L'analyse acoustique se concentre sur sept contrastes de vocaliques en anglais : /ɪ/ - /i:/, /æ/ - /ʌ/, /ɒ/ - /ɔ:/, /ʊ/ - /u:/, /æ/ - /ɑ:/, /ɜ:/ - /ʌ/ and /æ/ - /e/. Les scores Pillai révèlent que les informateurs ne maintiennent pas toujours les distinctions de contraste vocalique, bien qu'il y ait une variabilité substantielle entre les informateurs. Les analyses descriptives de /h/, /θ/, and /ð/ montrent que la fricative glottale est sujette à une variabilité considérable, la moitié des participants l'omettant fréquemment, tandis que les fricatives dentales sont plus souvent produits dans leur forme cible et les substitutions semblent varier en fonction des contraintes phonotactiques. Les échanges avec les chercheurs français attestent du fait que la prononciation est un sujet de préoccupation des chercheurs lorsqu'ils doivent communiquer en contexte académique. Il est donc important d'étudier son impact sur les auditeurs. La deuxième étude vise à évaluer l'intelligibilité et la compréhensibilité des productions orales de chercheurs français issues du corpus constitué dans la première étude. Les stimuli choisis comprennent trois conditions d'accent : un accent français marqué, un accent français non marqué et un accent SBE. L’évaluation est conduite auprès de 162 participants francophones et anglophones dans trois tâches de perception en reconnaissance de mots isolés, de mots insérés dans des phrases, et de compréhension du discours. Au-delà des performances examinées lors de ces tâches, des échelles de Likert relatives à des jugements de certitude, d’évaluation de la charge cognitive ressentie, de compréhensibilité et du degré d’accent ont également été recueillies. Les résultats montrent que les auditeurs anglophones obtiennent de meilleures performances dans les tâches de reconnaissance de mots lorsqu’ils écoutent un accent SBE plutôt qu’un accent français, mais qu’il n’y a pas de différence significative en fonction de l’accent chez les auditeurs francophones. Cependant, lors de l'écoute du discours, les deux groupes ont obtenu de meilleurs résultats lorsqu'ils ont écouté un accent SBE. Les jugements perceptuels ont suivi une tendance similaire. Cette étude fournit les premiers résultats sur la façon dont les auditeurs perçoivent l’accent français en contexte académique.
Titre
La prononciation des locuteurs français en anglais L2 en contexte de communication scientifique : entrave ou facilitation de l’intelligibilité et de la compréhensibilité du discours ?
Jury
Sophie HERMENT, Professeure, Université d'Aix-Marseille (rapporteur)
Alice HENDERSON, Professeure, Université Grenoble Alpes(rapporteur)
Paolo MAIRANO, Maître de conférences, Université de Lille (examinateur)
André TRICOT, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3 (examinateur)
Anne PRZEWOZNY-DESRIAUX, Professeure, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (Directrice de thèse)
Julie LEMARIE, Professeure, Université Toulouse - Jean Jaurès, CLLE (co Directrice de thèse)
Résumé
Lorsqu’un chercheur français présente ses travaux en anglais dans un contexte international, sa prononciation est-elle un obstacle à l’intelligibilité et la compréhensibilité de son discours ou au contraire, une difficulté désirable qui conduit les auditeurs à focaliser davantage leur attention ? De nombreux travaux ont été menés sur les différentes variétés L2, mais peu de recherches se sont concentrées sur le discours en L2 dans un contexte académique. Pourtant, les enjeux associés à l’efficacité de la communication dans ce contexte précis sont importants à la fois pour les individus au plan social mais aussi pour le développement de la recherche française à l’international. La thèse se fonde sur une approche interdisciplinaire avec deux études : 1) un protocole sociophonologique qui permet d’examiner le système interphonologique de chercheurs français en psychologie, et 2) un protocole expérimental visant à évaluer l’impact d’une prononciation française sur l’intelligibilité et la compréhensibilité en fonction de la langue maternelle (L1) de l’interlocuteur (anglais ou français) et du degré d’accent (marqué, non-marqué ou L1). Dans la première étude inspirée du cadre sociophonologique variationniste du programme Phonologie de l'anglais contemporain (PAC), treize chercheurs français en psychologie ont réalisé différentes tâches en production orale, constituant ainsi un corpus dédié à l’analyse acoustique et descriptive. Une condition contrôle pour la deuxième étude est élaborée sur la base de ces mêmes tâches réalisées par trois locuteurs anglophones avec un accent Southern British English (SBE). L'analyse acoustique se concentre sur sept contrastes de vocaliques en anglais : /ɪ/ - /i:/, /æ/ - /ʌ/, /ɒ/ - /ɔ:/, /ʊ/ - /u:/, /æ/ - /ɑ:/, /ɜ:/ - /ʌ/ and /æ/ - /e/. Les scores Pillai révèlent que les informateurs ne maintiennent pas toujours les distinctions de contraste vocalique, bien qu'il y ait une variabilité substantielle entre les informateurs. Les analyses descriptives de /h/, /θ/, and /ð/ montrent que la fricative glottale est sujette à une variabilité considérable, la moitié des participants l'omettant fréquemment, tandis que les fricatives dentales sont plus souvent produits dans leur forme cible et les substitutions semblent varier en fonction des contraintes phonotactiques. Les échanges avec les chercheurs français attestent du fait que la prononciation est un sujet de préoccupation des chercheurs lorsqu'ils doivent communiquer en contexte académique. Il est donc important d'étudier son impact sur les auditeurs. La deuxième étude vise à évaluer l'intelligibilité et la compréhensibilité des productions orales de chercheurs français issues du corpus constitué dans la première étude. Les stimuli choisis comprennent trois conditions d'accent : un accent français marqué, un accent français non marqué et un accent SBE. L’évaluation est conduite auprès de 162 participants francophones et anglophones dans trois tâches de perception en reconnaissance de mots isolés, de mots insérés dans des phrases, et de compréhension du discours. Au-delà des performances examinées lors de ces tâches, des échelles de Likert relatives à des jugements de certitude, d’évaluation de la charge cognitive ressentie, de compréhensibilité et du degré d’accent ont également été recueillies. Les résultats montrent que les auditeurs anglophones obtiennent de meilleures performances dans les tâches de reconnaissance de mots lorsqu’ils écoutent un accent SBE plutôt qu’un accent français, mais qu’il n’y a pas de différence significative en fonction de l’accent chez les auditeurs francophones. Cependant, lors de l'écoute du discours, les deux groupes ont obtenu de meilleurs résultats lorsqu'ils ont écouté un accent SBE. Les jugements perceptuels ont suivi une tendance similaire. Cette étude fournit les premiers résultats sur la façon dont les auditeurs perçoivent l’accent français en contexte académique.